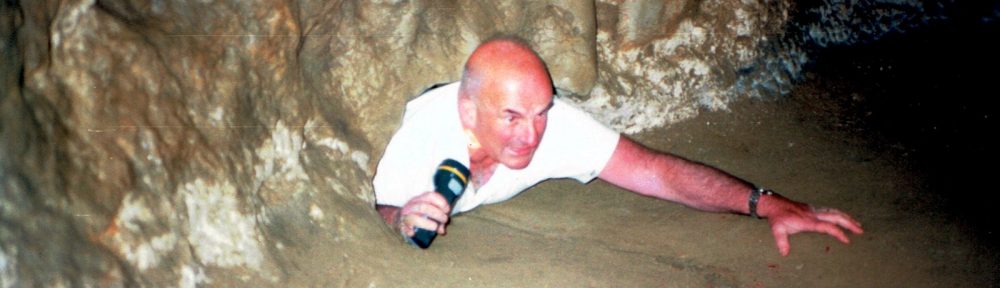Allongé à plat ventre sur le château arrière de notre boutre, me voici bien occupé à régler mon vaillant téléobjectif Leica de 180 mm braqué sur le port d’Assab qui se profile à l’horizon, ainsi que sur la côte éthiopienne déclarée zone de guerre et qui comme toute chose interdite, excite ma curiosité au plus haut point.
Ce matin, non sans un incontrôlable serrement de cœur, nous avons quitté les eaux territoriales françaises à Raz-Doumeira et salué le bouquet de palmiers-doum, plantés jadis sur le Cap-Raheita par ce grand seigneur local de la flibuste: Henry de Monfreid.
Ça y est, au poil, j’ai la grande mosquée d’Assab dans le viseur, je vais appuyer sur le déclencheur de prise de vues, mais voici qu’une main vigoureuse m’empoigne l’épaule gauche et me secoue frénétiquement. Je me retourne, furieux. C’est Guy de La Venne, le septième membre de notre groupe de douze, le visage décomposé, qui me lance affolé:
- Regarde ce qui nous arrive dessus !

Je me redresse et aperçois sur tribord une petite unité garde-côtes de l’antique marine de guerre italienne, passablement affectée par endroits de vastes plaques de rouille. Elle est montée par un équipage hirsute, manifestement pas suédois, mais cependant armé jusqu’aux dents. Quatre d’entre eux s’occupent fébrilement de dégager de sa jaquette de protection une sorte de canon de marine fixé sur la plage avant, pendant que d’autres alimentent en munitions leurs F.M. de type kalachnikov.
Je garde en mémoire un grand frisé vêtu d’un bleu de chauffe, maculé d’huile noirâtre, un mécanicien sans doute, armé d’un pistolet automatique, dont il fait, énervé, reculer la culasse pour l’armer. Manifestement, ce gars-là ne veut pas être en retard au carnage qui se prépare Tout cela menace de tourner très mal et très vite. Un vieux boutre sans radio, monté par des hurluberlus désarmés, dégagé par le fond sur une mer déserte et interdite, à la nuit tombante, qui viendra un jour s’en inquiéter? Ils ne porteront sans doute même pas l’incident sur le journal de bord.
Le voici maintenant à couple et notre vénérable coque de bois craque, pitoyable et sinistre, lors des chocs contre la paroi de métal du patrouilleur, en cette mer formée de vagues hargneuses et méchantes. Je suis le seul à porter une casquette militaire à couvre-nuque, une chemise à épaulettes, et cette allure martiale focalise leur attention sur moi.
Celui qui semble être le commandant m’invite sèchement à monter à son bord. Avec ces gens-là, il faut toujours opérer dans l’outrance, la démesure, le superlatif. En conséquence, je multiplie les saluts militaires outrageusement prestigieux, compassés et austères: comprenez d’abord que nous sommes entre guerriers, et qu’ensuite flatter l’orgueil d’un homme, c’est imparable, quels que soient le continent, l’époque ou la longitude. Nous sommes ainsi faits depuis la sortie du jardin d’Eden.
Talons joints, je mets d’emblée toute la gomme par un tonitruant: «LA ILAI YA ILL ALLAH OUA MOHAMMED RASSOUL ALLAH » (Il n’est pas d’autre dieu que Dieu et Mahomet est l’envoyé de Dieu). J’ai fait mouche, voilà le pacha interloqué et désemparé, mais il n’est pas question de laisser refroidir la soupe. Aussi, nouvelle et plantureuse ration de saluts militaires. Conciliabule chez les Suédois qui, la mort dans l’âme, rangent leurs kalachnikov et décident de nous escorter avec eux à Assab.
Le patron me coule par moment un regard plein d’amertume et de suspicion. Il se demande si je ne l’ai pas roulé dans la farine et privé d’un divertissement sanglant et inespéré comme ils les aiment tant. En contrepartie, il a le droit à une resucée de saluts militaires sous ma casquette Bigeard et, de temps à autre, à une nouvelle invocation d’Allah, yeux de braise dardés et index droit tendu vers le ciel.
Nous sommes en approche du port d’Assab, une vague appréhension nuance son regard. A chaque invocation d’Allah, il me regarde comme si, pris d’une pulsion soudaine, j’allais brutalement le mordre car, petit à petit, il en est venu à la conclusion fort logique que je devais être complètement fou. Et les fous, en pays musulman, sont parfois considérés comme des interprètes de la parole divine, il ne faut pas l’oublier.
Il a quand même la radio à bord, ce cher Olaf (je l’appelle Olaf), car un comité d’accueil nous attend sur le quai. Encore des Suédois! Ordre nous est donné d’évacuer le bateau et de coucher sur le quai sous la surveillance des sentinelles. Non! Non! Et non : pas le droit de photographier les sentinelles ni les véhicules militaires.

Je passe les détails : Salem, par exemple n’a aucun papier, ne sait pas où il est né, s’il est afar, somali, berbère trégorrois ou cornouaillais. C’est notre nacouda mais il est incapable de lire une carte et de se servir d’un compas, raison pour laquelle, en route de Djibouté vers les Hanish, il est entré en plein dans les eaux territoriales éthiopiennes, incapable de naviguer s’il perdait de vue le littoral.
Serge Guyomarc’h, lui non plus, n’a aucun passeport et se planque dans le bateau, échappant aux fouilles. Par moments on aperçoit sa bobine tourmentée surgir d’une écoutille, de l’écubier, la tête en bas ou de travers, quémandant des nouvelles, plein d’angoisse, et recevant en retour des «Planque-toi, nom de Dieu » furibards.
Vers dix heures du matin un cortège de trois voitures vient débouler en trombe sur le quai n°5 du port d’Assab où nous sommes parqués dans l’attente de connaître notre sort. Des deux premières sortent des soldats et deux officiers subalternes, le chauffeur de la troisième ouvre la portière au colonel commandant les forces éthiopiennes d’Assab, encerclé à l’époque par les rebelles érythréens d’Asmara.
Coiffé de mon habituelle casquette Bigeard, saharienne mastic et pantalon de toile kaki, j’avais pris le contrôle de la situation et adopté la figure de circonstance.
Je revois le colonel qui s’avance vers moi. Alors, en me figeant au garde-à-vous en un salut impeccable, je sus d’instinct que la partie était gagnée et que j’allais rafler la mise.
Comment vous l’expliquer ? Ce colonel de l’armée éthiopienne, c’était ni plus ni moins que le frère jumeau de Vittorio Gassman, figé dans un même sourire ensorcelant. C’était le cousin issu de germain de Marcello Mastroianni, avec la semblable moue lascive qui lui figeait le bas du visage. Et il me saluait d’une voix aux intonations troublantes, aux modulations mélodieuses et chaudes. Il n’y avait pas à s’y tromper, c’était la voix de Luciano Pavarotti.
Sur ce quai qui avait autrefois perdu son âme se matérialisait sous mes yeux fascinés un Bersaglieri de Torre-Annunziata, parfumé de musc et de bergamote, qui était venu jadis, moustache conquérante, débarquer sur ces rivages heureux qu’éblouissaient les feux d’un soleil monotone, pour épancher son cœur d’un trop plein de tendresse et de flamme.
- Subito! Subito!
Je n’osais me présenter sous le nom de Giovanni Badoglio car il avait en main mon passeport mais j’évoquai quand même, pour mémoire, une lointaine ascendance piémontaise et, d’instant en instant, une chaude connivence montait de notre rencontre, comme une molle écharpe de brume d’extrême automne, à la surface d’un étang de Sologne aux premières heures de l’aurore. Je finissais par me demander si nous n’étions pas, en ce moment béni, en train de rejouer les retrouvailles de Judas Ben-Hur et du tribun Messala, dans la vaste salle d’armes de la Tour Antonia à Jérusalem.

Et voilà, c’était fini, il nous rendait nos passeports. A ma demande insistante, il finit aussi par relâcher Salem, notre vieux nacouda, qu’il voulait d’abord garder parce que, malgré le sévère passage à tabac de la nuit, cet éventuel espion ne se souvenait toujours pas s’il était né somali ou cornouaillais.
- N’allez pas aux Hanish, insistait le colonel, c’est une terre maudite, vous n’en reviendriez pas vivants.
Et de nous souhaiter un bon retour à Djibouti. Mais son œil, pétillant de malice, disait qu’il n’y croyait pas beaucoup. Abrazzo à la mexicaine, étreintes, yeux humides, «Pourquoi es-tu venu si tard?», échanges d’adresses…
Le boutre maintenant larguait les amarres et commençait à s’éloigner du quai, le colonel et ses officiers figés sur l’appontement. Alors, je ne sais pas ce qui nous a pris: Il tendit les deux bras vers le ciel, en un ultime adieu, et je fis de même, mais je sentais qu’il passait au-dessus de moi et voyait dans un brouillard immatériel Nectanébo II, dernier pharaon de la XXXème dynastie, mystérieusement disparu sur ces rivages éthiopiens, poursuivi par les Perses de Darius, il y avait si longtemps.
Soudain, je me mis à chanter:
Salve o popolo d’eroi
Salve o patria immortale
Sun rinati i figli voi
De l’appontement il me répondit:
Con la fede à l’ideale
la visione dell Alighieri
Oggi brilla in tutti cuor
Et tous les deux, soudain l’âme en fête:
Giovinezza, giovinezza
Primavera di belleza
Nella vita e nell asprezza
il tuo canto squilla eva
Assab s’éloignait, le colonel se perdait dans le lointain, quittait l’appontement.
Je ne l’ai jamais revu. C’est la vie, voyez-vous, mais c’est la vie dans ce qu’elle a de moche. Cher colonel, si peu entrevu, malheureux aristocrate égaré, qui n’avait pas sa place dans les armées de Mengistu Hailé Mariam, ce sauvage. Lui et ses officiers, restés fidèles à Hailé Sélassié, le Roi des Rois, ont fini assassinés en d’obscurs combats.
Mais le vent a chassé l’odeur des cadavres et il ne reste plus dans notre mémoire que le flamboiement de notre jeunesse. C’était sans doute un rêve et la vie est un massacre de rêves, un cimetière de rêves, piétinés, trahis, vendus, abandonnés, oubliés.
Quel gâchis!
(Pierre Schoendoerffer)