
« La gaieté, au fond c’est un camouflage. Je ressens très fort la douleur du monde, la Weltschmerz, mais je ne le dis jamais. Le tragique du siècle m’a beaucoup agité. »

Raoul & ses collaborateurs vous présentent
« Castigat ridendo mores ! »
Le réveillon de Lezarouan
Avec foie gras truffé, spécialement revisité par
Sixtine Baader et Pierre-Baptiste Lambert, éleveurs-gaveurs à Ribeauville
Huîtres Gillardeau de Marennes-Oléron
Saumon fumé Fairbanks du bas-Saskatchewan
Gigot de mouton pompe du plateau du Larzac
Bavette de bœuf black angus
Grand plateau des fromages de France
Et, pour finir,
Vacherin aux framboises de l’Esterel
Issu des laboratoires Hervé Bourdon & fils.

Mais aussi, j’allais l’oublier, avec Jean-Sébastien Bach et son orchestre ! Tout un programme, n’est-ce pas ? Ce n’est plus un réveillon mais une épopée. Et je vous la livre ici toute crue, cette chanson de geste.

Passent les mois, passent les années, passent inexorablement les siècles. A Pont-Prenn, dans l’anse de Suguensou, ce mélancolique bras mort du Goyen, les bandes jacassantes de corneilles, immuables, pleines de cris et de poursuites, s’acharnent à sillonner les ciels de septembre si chargés de nuées vaporeuses.
Chaque jour, à la brune, une heure environ avant le crépuscule, elles prennent leur essor en bandes agitées et braillardes, se dispersent en folles brassées de feuilles mortes à tous les vents de l’extrême-automne et dessinent leurs noirs maléfices dans les tristes brouillards du proche océan.

Le chef de groupe lance soudain un croassement d’attaque éclatant, Crrroâââ! Crrroâââ ! et la multitude reprend aussitôt avec enthousiasme Crrroâââ! Crrroâââ !
Elles y mettent tant de chaleur et d’allégresse qu’on ne peut s’empêcher de penser que cette façon de pousser ces cris les valorise au niveau du groupe et leur donne un statut social. Ce faisant et par le truchement de ces vocalises gutturales et rauques, elles intègrent l’élite des corneilles et le proclament au sein des futaies qu’envahit l’ombre de la nuit.
Réfléchissez bien. Il est en effet des cris, des vociférations, des expressions verbales qui, à quelque degré de l’échelle animale qu’elles fussent dites, non seulement vous réjouissent la gorge de par leur élocution même, mais encore vous situent, dans l’instant qu’elles sont prononcées, à un niveau précis de la hiérarchie du groupe.

Un brin d’explication. Vous êtes invité en rallye chez feu le comte Jean d’Ormesson ou, pourquoi pas, chez le prince Stanislas Manfred Foulque de Faucigny-Lucinge Coligny et Madame, née Ysabel Catarina Pilar Emilie Natividad Terry y Dorticos. (Natividad, sa divine moitié tropicale, est d’origine brésilienne, tombée dans le café à l’âge de trois mois, avec les dollars qui vont avec).
Le prince vous reçoit : « Comment, Fulgence Charles Henri, mon ami, votre épouse ne vous a pas accompagné ? » Si vous ouvrez tout grand le bec et répondez en battant des ailes : « C’est t’y pas que ça soye pour vous contrarier, M’sieur not’ Maître, mais ma femme est tombée enceinte », vous êtes dans l’instant catapulté à l’office pour la corvée de patates.
En revanche, si vous laissez négligemment tomber : « Hélas non, Altesse, Esclarmonde (ou Gersende, Xénia, Quitterie), victime d’un subit flux de poitrine et d’un dérangement de corps, a dû s’aliter. En ce moment, Corvisart est à son chevet. Elle profite d’ailleurs de ce repos forcé pour se replonger dans l’interprétation de Glen Gould, des Variations Goldberg ! »
Savoureuses délices de certaines paroles prononcées ! Jean d’Ormesson peut aller se rhabiller !

Un film traitant de la vie à Rome sous l’Empire passait l’autre soir aux étranges lucarnes. On y voyait Octave Auguste s’adressant au Sénat, scène relativement banale dans les péplums, mais il haranguait les sénateurs en latin et on prenait immédiatement conscience de tout ce que cette langue pouvait avoir de classe et de noblesse ensorcelante, c’était à en avoir les larmes aux yeux de plonger de manière si inopinée dans une ambiance de Surhumanité blanche.
Chez l’ami Michel, l’assistance, sous la direction du maître de maison, récite d’habitude le benedicite avant de s’asseoir à table. Je vous assure qu’on perd dans l’instant toute envie de sourire et que se met à flotter, presque hors du cadre religieux, dans une pérennité rituelle mais où le sacré, le lien de la vie et de la mort, devient une sorte d’émulsion, cette lumière mate, uniforme, où s’ouvrent de grands yeux.

Je reviens au réveillon. Nous étions donc neuf à fêter de concert ce passage à la nouvelle année. Jacques et Philippe firent une entrée impressionnante en majesté et si grande tenue que j’en demeurai pour ainsi dire mortifié, un peu triste de n’avoir point songé à me mettre au diapason.
J’éprouvais la vision très fugitive de Philippe, ce magnifique type ethnique, sur qui les siècles paraissaient avoir eu si peu de prise. Il n’était guère d’effort à fournir pour l’imaginer debout, coiffé d’un casque cornu, masqué de bronze, trempé d’écume, à la proue de son drakkar, cherchant la grotte de Fingall, sur l’île de Staffa.
Qu’aurait d’ailleurs pensé ce lointain prince viking de l’Atlantique Nord s’il avait pressenti qu’un jour, son descendant pétrirait des amalgames, s’acharnerait en détartrages et ne consacrerait plus dans les clairières de divinités sauvages en les coiffant de somptueux diadèmes de thym et de marjolaine mais se contenterait de coiffer de grosses molaires malodorantes, de petites couronnes d’or, et d’inlays d’acier ?
Marie-Hélène le suivait en grande forme, ce qui nous fit plaisir à tous. Il y avait aussi Nicole, très jeune, coiffée à la garçonne, tellement style Jeanne Avril que les silhouettes ombreuses d’Offenbach et de Toulouse-Lautrec flottaient tout émues dans son sillage odorant de musc et de verveine.
Nous étions quatre à recevoir ces deux couples : votre serviteur ouvrant les fameuses huîtres Gillardeau (si ça n’en était pas, elles méritaient cent fois de l’être), Martine ma chère épouse, mon vieil ami Yves et sa compagne Pascale qui, pour l’occasion, soulignait son style exotique d’une fort seyante robe équatoriale, cette robe dont le décolleté intrépide transportait l’examinateur attentif, qui en fixait le sillon obscur, ni plus ni moins qu’au fond du Grand Canyon du Colorado. Admirons encore un peu. Voyons ! Voyons ! Oh oui ! J’oserai même préciser : pas loin de la precambrian unconformity où abondent schistes de Vishnou et granits de Zoroastre.
Nous étions donc huit au rez-de-chaussée dans l’attente que sonnât minuit mais, en auditeur attentif, vous allez me dire : « Ne m’aviez-vous pas parlé de neuf convives ? » Si fait ! Mais si je n’ai pas encore évoqué le neuvième, c’est qu’il est au premier étage et qu’il me faut maintenant l’aborder.

C’est Lui !!! Lui ! et je ne dirai pas « tout simplement » en évoquant cet individu considérable car Lui, c’est, ni plus ni moins que Jean-Sébastien Bach ! D’ailleurs, je me demande si je ne l’entends pas déjà ronfler. Ne bougez pas, vous dis-je, vous le réveilleriez, il dort sur son petit traversin de lauriers.
Si, si ! Je suis sûr qu’il lui arrivait parfois de ronfler, Jean-Sébastien Bach !
Dame ! Gros buveur de bière, gros ravageur de saucisses, de cafés et de pousse-cafés. Les portraits du Kapellmeister, à la nuque bovine et au teint rougeoyant, ne laissent en ce domaine planer aucune équivoque.
Il lui arrivait de parcourir 400 km à pied pour rejoindre la cathédrale Sainte-Marie de Lübeck, où l’on donnait l’intégrale des cantates de Dietrich Buxtehude (1637-1707), en particulier la cantate BWV 71 dont il s’inspira. A Weimar, on lui en fera le reproche : « Monsieur, comment se fait-il que, depuis votre retour de Lübeck, vous introduisiez dans vos improvisations – beaucoup trop longues d’ailleurs – des modulations telles que l’assistance en est fort troublée ? »
A Weimar, trouvant lui-même les sermons trop longs, il en profitait pour s’éclipser dans un bar à vins où il lutinait sa cousine et bientôt épouse, Maria-Barbara au timbre délicat de soprano léger. Lourdement besognée par le cantor, elle chantait d’une voix cristalline « A-a-a-a,Ah-Ah-Ah, Aaaaah ! Aaaaah ! Ouîîîî ! Ouîîîî ». Etait-ce un prélude aux Variations Goldberg ?

Chose étrange, passé maître dans l’art de la fugue, le Kappelmeister paraissait d’emblée moins opérationnel et, disons, moins rompu dans l’art de sauter en marche. C’est ainsi que Maria Barbara eut quand même le temps de lui donner sept enfants avant de mourir tout essoufflée.
Bach extériorisa pendant une année entière les marques bouleversantes d’un chagrin désespéré et inconsolable. C’est simple, on craignit même un moment qu’il ne perdît la raison mais, se rendant compte soudain de ce que cet état d’esprit avait de providentiel pour un artiste de sa trempe, il se dépêcha, usant sans mesure de l’émotion du moment, d’écrire une œuvre pleine de tendresse émue, Ode funèbre à la mémoire de la princesse Christiane Eberhardine.
Las ! Ce qui est effrayant dans la perte d’un être cher, c’est moins la douleur qu’on en éprouve que la rapidité avec laquelle on en est consolé ! Certes, il ne reprit ses esprits et sa bonne humeur qu’au bout de quelques mois lorsque le coquin dénicha sa seconde épouse, auprès de laquelle, il ne se montra guère moins empressé puisqu’il ne parvint pas à la féconder moins de treize fois, ce qui portait l’évaluation de sa progéniture à vingt individus ! Et je ne parle bien entendu que de la descendance officielle !
Bach, Jean-Sébastien Bach ! Aujourd’hui, il est mort, Bach, et bien évidemment ça nous démange. Faut-il pour cela s’inquiéter avec tous les Portugais du monde, qui se demandent : « Mais qu’est-ce donc que Bach-a-la-haut ? » Que Dieu l’ait en sa très sainte garde, lui qui l’a tant servi entre deux galipettes.

Jean Sébastien Bach ! Pardon, plus exactement Jean-Sébastien Bloch car, ne l’oublions pas, Bach était d’origine juive, ashkénaze pour être exact et, en homme de précaution, prévoyant la montée irrésistible du nazisme en Allemagne – seuls les artistes, à des siècles de distance, sont capables d’une telle prescience, NDLA – plutôt que de faire porter un jour l’étoile jaune à ses descendants, il avait germanisé son patronyme !
Bach ! On l’a, pour ainsi dire, canonisé de son vivant. On a écrit qu’il était le cinquième évangéliste. On lui a élevé des statues dans maintes églises luthériennes.
Jean-Sébastien m’évitait au moins, ce soir-là, d’assumer la sinistre position de doyen d’âge car il était né en 1685, d’une interminable lignée de musiciens.

Ce Bach ! Il a donc beaucoup travaillé ? Oh que oui, il a travaillé. C’était un producteur, fécond s’il en fut. Jugez-en : deux-cent-quatre-vingt-quinze cantates d’église auxquelles s’ajoutent cent quatre-vingt-cinq chorals harmonisés à quatre voix, sept cantates profanes, quatre passions, quatre messes brèves, dont celle en si mineur, justement portée aux nues, quatre sanctus, six magnificat, des oratorios, la passion selon Saint-Mathieu, plus de deux cents pièces d’orgue. Excusez du peu !
Son œuvre est un univers sonore et l’art polyphonique de la Renaissance y atteint son suprême épanouissement. Les hardiesses de son inspiration et de son style sont un peu comme les prolégomènes à toute musique future. Et cetera, et cetera, disait Anton Brückner, autrement si cher à mon cœur ! J’entends déjà certains mauvais esprits ricaner : « Et pour cause ». Oui ! Le catalogue de Bach est bien conforme à l’abondance de son siècle. Celle-ci nous trouble même un peu chez lui, car on est tenté de reconnaître qu’elle ne pouvait aller sans une production de série. Une notion qui paraît sacrilège, appliquée à Bach. Il a eu lui-même, pourquoi ne pas le dire, non pas des heures de faiblesse mais de routine. Eh oui ! Je dis bien de routine, où la main, l’habitude peut-être, gouvernent le travail tandis que l’esprit créateur somnole.
Le culte instauré autour de son génie a fini, comme tous les cultes, par engendrer une certaine hypocrisie. Sans doute un refus scandalisé de tolérer sur son œuvre la moindre réserve, derrière quoi le dévot dissimule, souvent à son insu, l’ennui désertique ou l’hébétude vague qui ont été ses véritables sensations.
Le parti pris chez Bach d’accompagner de bout en bout une pièce vocale avec la même disposition d’orchestre ou le même instrument soliste est une facilité dont il abuse. A tout le moins un trait d’archaïsme. Il y a, selon le mot d’un musicographe allemand quelque peu iconoclaste, « le Bach à sa machine à coudre ».

Prenons, par exemple. Les deux concertos pour violon, très agréables, bien sûr, mais d’une coupe assez primitive, virtuosité au fil de l’archet coupée par un refrain immuable, et dont l’authenticité est au reste discutée. Ils ne peuvent évidemment être mis sur le même plan que des œuvres magistrales comme les Brandebourgeois.
D’une cantate à l’autre et même, parfois, à l’intérieur d’une même cantate, on passe d’un aria admirable d’émotion et de noblesse à des enfilades de vocalises tout à fait conventionnelles. Il est d’ailleurs plaisant de voir les dévots savourer religieusement ces italianismes flagrants, pour lesquels ils n’auraient pas assez de mépris si on les leur présentait sous leur véritable étiquette, celle du bel canto napolitain.
Sur le même plan que Bach, celui des suprêmes génies de toute la musique, Mozart et Beethoven, ont été des artistes plus sensibles, bien plus étroitement mêlés à l’aventure humaine. Et Richard Wagner un plus grand inventeur, si ce n’est le plus grand. Certes, comme le dit si bien l’un de mes amis, pianiste de profession, « la musique de Bach se caractérise par des artifices et subtilités d’ordre intellectuel et non particulièrement sensoriel. Elle se passe donc aisément de raffinements techniques dans l’intelligence de sa reproduction sonore. Ceci est tellement vrai que Bach, pour l’exécution de son Art de la fugue, n’a indiqué aucun instrument. »
Cependant, avait coutume de proclamer l’un de mes vieux amis, proscrit comme moi, jamais organisation musicale plus puissante, plus parfaitement commandée que celle du cantor de Leipzig n’a logé sous le crâne d’un mortel.

Venons-en maintenant, après ce long préambule, au vif de notre sujet. Le comte de Keyserling, ambassadeur de Russie à Dresde, mélomane averti comme on l’était de son siècle et aussi de son pays, souffrait d’insomnie chronique. Il s’en ouvrit à Goldberg, son claveciniste, qui en vint à parler à son maître, Jean-Sébastien.
C’est donc à cette occasion que Bach créa ces Variations, dont il emprunta le thème au Petit manuel de clavecin pour Anna Magdalena. C’est soi-disant une sarabande mais les trente variations s’occupent bien plutôt de la basse que de la mélodie, de sorte que cette œuvre ressemble furieusement à une chaconne, je dirai même à une simple passacaille. Il s’agissait tout simplement de distraire, ou de faciliter l’endormissement du comte.
Las ! Il aurait fallu une exceptionnelle pénétration au comte de Keyserling pour qu’il comprît la portée du badinage que Bach lui avait envoyé. En effet, sur un air de sarabande, les trente Variations Goldberg réduisent à rien tout ce qui avait pu paraître sous cette rubrique en Europe.
Avec le recueil Goldberg, la variation devient un principe complet de développement, elle transforme la substance même du thème, ce thème est traité comme l’instrument d’organisation d’une série de pièces, indépendantes les unes des autres mais dépendant toutes du même agent formel.
La sensibilité même de cette musique dépasse son siècle. Sur des rythmes dont pas un seul ne reparaît deux fois, elle bondit, scintille, plaisante et rêve. Elle s’émeut comme dans un album romantique. Et toute cette fantaisie est strictement gouvernée par neuf canons différents, un toutes les trois variations, augmenté chaque fois d’un ton, jusqu’à la vingt-septième variation où le canon est à un intervalle de neuvième.
Je pense qu’il est maintenant inutile de poursuivre et que vous avez bien saisi que tout cela n’est pas destiné à vous frapper au ventre, que ce n’est pas au son des variations Goldberg que la Garde Impériale a chargé à Austerlitz sur le plateau du Pratzen. Et pouvez-vous concevoir, vous, les sublimissimes et tendres adieux de Wotan à Brünnhilde accompagnés par les Variations ?

Ce qui me paraît surtout évident, c’est qu’à mon humble avis, cette composition ne s’adresse qu’à une petite élite de musiciens professionnels qui, seule, sera capable d’en extraire l’intégralité de la substantifique moëlle, musiciens de préférence d’au-delà du Rhin et pas, évidemment, un auditoire français. Pourquoi donc ? Détaillons, s’il vous plait cette constatation. Lors de ma jeunesse folle, très influencé par le frère aîné de ma mère, je me suis beaucoup occupé de musique. Mon oncle était prêtre et professeur d’allemand. L’Allemagne était sa patrie spirituelle. Né français, il était allemand de cœur et, oserais-je dire, de substance. Il me donnait des cours de piano. Je le vois encore chantant des lieder en s’accompagnant de ce noble instrument.
J’ouvre une nouvelle parenthèse qui me semble indispensable, car il s’agit d’évoquer aussi un grand roman méconnu, qui est pour moi l’une des œuvres littéraires maîtresses du siècle. Chaque page de mélancolie et de souffrance vous inflige sa dose de délicieuse tristesse et de spleen. On dirait un simple coup de stylet. Vous saignez, bien sûr, mais un peu, pas énormément, ce qui vous permet d’attendre la 336ème page avant que l’hémorragie ne vous tue.
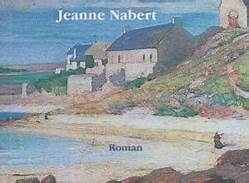
C’est l’histoire navrante du docteur Guyonwarc’h, Le Cavalier de la Mer. Il s’agit d’une naissance en apothéose du cap Sizun et aussi de Jeanne Nabert qui l’avait épousé, ce cap Sizun, un peu à la manière des noces barbares de Yann Gaos et de l’océan sur le grand banc de Terre-Neuve, mais aussi son chant funèbre. Le loup du Ménez-Hom, cette brute sauvage de Guyonwac’h, avait-il jamais aimé son épouse Eudoxie ? Nul ne saurait le dire.
Cette jeune femme ravissante et frêle, était manifestement incapable d’affronter la rude existence des gens du cap, ces êtres couleur de roc, patients comme des éternels, qui rendent par hoquets une langue pauvre, presque éteinte, qui ne sait ni rire, ni pleurer.
Il me souvient de l’avoir vue, un soir de mai sur la terrasse de son jardin, au milieu des seringas dont l’odeur faisait mal à la tête. Les pointes de son châle blanc s’ouvraient comme deux ailes au vent du printemps. On entendait rire le coucou dans les bois des collines. Le concert des grillons sur la lande autour de la ville s’élevait comme un cercle magique d’esprits moqueurs. Quand elle fut emportée par la peste, il ne donna pas de marques extérieures de chagrin mais, à dater de la mort de la fragile jeune femme, personne ne l’entendit plus jamais chanter ni jouer de cette flûte dont il usait chaque jour.

Quand mon oncle fut assassiné en Algérie, j’abandonnai moi aussi le piano mais j’assistais toujours régulièrement aux concerts donnés en ville. Au théâtre Graslin de Nantes, où j’avais mes habitudes, le privilège me fut donné d’entendre Yehudi Menuhin et aussi le plus brillant élève de Piotr Solomonovitch Stoliarski : l’incomparable David Oïstrakh, dont je possède toujours une partition qu’il m’avait alors dédicacée.
David Oïstrakh jouant d’un stradivarius « Comtesse Fontana » ou de son autre instrument, le « Prince Youssoupov » ! Grand souvenir !
A l’issue d’un concert, au foyer du théâtre, l’un de mes amis qui cultivait quelque connaissance slave, ravi de montrer la pratique et la maîtrise qu’il avait de cette langue magnifique, lui demanda soudain : « David Fiodorovitch, on me dit que lorsque vous donnez un concert en France, les amateurs qui ont assisté à vos prestations au-delà du Rhin vous trouvent céans préoccupé et nerveux. Y a-t-il une raison à cela ? »

L’artiste, timide et plein de prévenance, nous avoua, non sans difficultés, que dans ce pays, la France, il était hanté par l’idée qu’il ne pouvait observer un temps de silence entre deux mouvements sans que les spectateurs n’éclatassent en acclamations frénétiques. On dirait, affirmait-il, qu’au lieu de porter l’attention qui convient à la musique, ils se surveillent les uns les autres pour être parmi les premiers à applaudir et qu’ils se trouveraient honteux de ne pas manifester de manière disproportionnée et bruyante toute la jouissance qu’ils sont censés avoir tirée de l’audition d’un morceau, fût-il complexe au point de ne pas leur être accessible.
Or, vous connaissez l’importance des silences dans une pièce de musique, importance si capitale qu’on en vient à se demander si elle ne correspond pas à l’Approbation de Dieu, qui se dévoile à ce moment. Ce faisant et par pur snobisme, disons-le maintenant sans hésiter plus avant, les Français se privent d’un moment d’essence surnaturelle, le Silence de Dieu, Dieu qui est silence dans l’éternel !
J’écrirai un hymne au silence, disait-il, s’exaltant soudain. Silence, toi, musicien des fruits. Toi ! Chant des fontaines ! Habitant des caves, des grottes, des celliers et des granges. Toi ! Vigilance de Dieu sur notre fièvre, manteau de Dieu sur l’agitation des hommes, repos de la mer sur sa plénitude !
Ah, Seigneur, qu’un jour, engrangeant votre création, vous ouvriez ce grand portail à la race bavarde des Hommes et les rangiez dans l’étable éternelle, quand les temps seront révolus, et enleviez, comme on guérit des maladies, leur sens à nos questions.

31 décembre 2012. Il est maintenant 21 heures et grand temps de se mettre à table. Quelle somptueuse table ! Chef-d’œuvre d’ébénisterie moderne pensée, conçue et élaborée par le génie saugrenu d’un de ces farceurs qui se sont à notre époque affublés d’une notoriété ô combien usurpée, un nommé Charles Eames, dont l’art fort singulier consistait d’ordinaire à fabriquer d’invraisemblables sièges sur lesquels il était impossible de disposer confortablement son séant sans éprouver dans l’heure les affres d’une térébrante névralgie sciatique.
Cette table, chaque convive s’émerveille ce soir de la trouver soir habillée de vastes serviettes évoquant les plus beaux drapés de la statuaire grecque, chers au docteur Gaëtan Gatian de Clérambault, illustre élève de Charcot et père de l’érotomanie moderne.
Oui ! En cette sombre période de disette et de déchéance socialistes, notre hôte-gynécologue qui, comme tous les Français désormais acculés aux économies extrêmes, avait jugé raisonnable, avant de solliciter son passeport russe auprès du grand Vladimir, de récupérer ses draps d’examens pour en diversifier l’usage, les réutilisant avec sobriété en guise de confortables et vastes serviettes de table.

Raoul, tout fier de démontrer la finesse de son sens olfactif, n’avait-il pas jadis souhaité devenir un nez chez Guerlain, passait de siège en siège, s’emparait de chaque serviette dont la fragrance s’exaltait au contact de la tiédeur des genoux des convives et, la flairant longuement en chien de chasse rompu aux hallalis de haute futaie, laissait tomber un diagnostic infaillible qui abandonnait ses amis fort admiratifs et pantois : « Ici nous avons une première leucorrhée, chez une collégienne d’environ quinze ans, milieu de petite bourgeoisie catholique mais non pratiquante. Là une vaginite à pseudomonas aeruginosa chez une retraitée athée de l’enseignement laïc, aux cuisses et au menton poilus, adhérente à la M.G.E.N., membre du comité directeur d’Amnesty International. Ici, plus corsé, nous sommes en présence d’un transsexuel brésilien rapatrié d’Afghanistan, chauffeur poids lourds dans une entreprise de bières et charbon ».
L’extrême pertinence de chaque diagnostic, confirmé par le praticien, était saluée par des cris d’approbation et d’enthousiasme sans mesure. Amateur connu de munster fermier, Raoul s’était réservé les pièces spéciales, discrètement imprégnées d’humeurs anaérobies, de trichomonas et autres gardnerella vaginalis au bouquet plus robuste et aux remugles plus sauvages.

Couverts installés, serviettes distribuées, Yves et Pascale débarquèrent un fabuleux plateau d’huîtres, iodées, charnues, croquantes, si délicieusement fraîches sur leur lit d’algues et de glace qu’il en émanait une surprenante saveur de noisette et de varech fraîchement déposé sur la grève par le dernier grand coup de suroît. Elles étaient si onctueuses qu’on avait mille peines à les retenir en bouche avant qu’elles ne glissassent prestement vers les choanes.
Il fut très vite impossible de modérer l’enthousiasme et la fièvre des convives. Ils se levèrent tous d’un commun accord et, entraînés par l’impétuosité de Jacques, se tenant par les épaules, entamèrent un monôme frénétique et sauvage autour de la table Charles Eames. Un rustique fumet de fucus vésiculeux, de rivage breton à marée basse parfumait leur haleine pendant qu’ils hurlaient en chœur et en cadence une sarabande chaloupée.
Un fabuleux saumon fumé sauvage de l’Ouest canadien suivit en majesté et c’est précisément là que, comme un coup de tonnerre zébrant un ciel d’été, le drame se joua : Tout le monde avait oublié le vin ! Personne n’avait pensé au vin ! C’est simple, il n’y avait pas de vin !
Enthousiaste et zélé, Jacques avait bien proposé de s’en charger comme d’habitude, en commandant sur internet ses merveilleux crus auxquels il manifestait une indéfectible fidélité : Vieux Château Certan, Ausone, Cos d’Estournel, Léoville Poyferré, Cheval Blanc, Ducru-Beaucaillou, que sais-je encore ?
En raison de la situation précaire de certains convives qui, plongés dans l’incommodité d’une retraite spartiate et austère de médecin de campagne, souffraient à la pension Vauquer, des deux sexes et autres, de la gêne pudique mais digne du cousin Pons, on avait évoqué au cours de la longue vesprée de préparation, d’autres propositions auxquelles personne n’avait songé donner suite.

A 22 heures, au plus noir de l’hiver, de la nuit de la Saint-Sylvestre et de la guerre au Mali, sans le moindre espoir de trouver un magasin ouvert, il fallait se résigner devant l’horrible évidence, la nuit allait se passer sans vin. Toute la nuit !
« Songe ! Songe, Céphise, à cette nuit cruelle qui fut pour tout un peuple (breton !) une nuit éternelle ».
Autour de la table, la joie sereine avait soudain fait place à une torpeur lugubre, à un abattement sinistre, à une prostration mélancolique et navrée. Pouvez-vous seulement l’imaginer ? Huit convives français, sans vin, qui se jetaient des regards glacés, déjà agressifs, presque redoutables ?

Les Français aiment le vin, c’est une évidence, une vérité d’évangile. Jadis, aucun Français n’aurait su avouer qu’il n’aimait pas le vin. C’eût été comme de dire qu’il n’aimait pas ses enfants et pire, car il arrive partout qu’un père en vienne à détester son fils mais on n’avait jamais vu en pays viticole quelqu’un ne pas aimer le vin ! C’est une malédiction du ciel et, pour quels péchés, un égarement de la nature, une difformité monstrueuse qu’un homme sensé et bien buvant se refuse à imaginer.
On peut ne pas aimer les carottes, les salsifis, le rutabaga, la peau du lait cuit.
Mais le vin !!! Autant vaudrait détester l’air qu’on respire puisque l’un et l’autre sont également indispensables !

Après avoir ingurgité force huîtres avec beaucoup de discrétion maladroite et encore plus de voracité soudain déchaînée, Raoul, le plastron constellé de taches comme à son habitude, ce qui désespérait son épouse, Raoul, lui, pensait maintenant au vin.
Il y pensait avec une ferveur sensuelle, parfois véhémente, et sentait alors toute son âme se nouer dans sa gorge en feu. D’humeur renfermée, il ne faisait part à personne de cette soif de vin qui le ravageait depuis six bonnes heures mais, à mesure que la soirée se prolongeait, il s’abîmait dans des visions de bouteilles, de tonneaux et de litres de rouge. Sans sortir de sa rêverie, prenant tout à coup une sorte de recul et considérant cette rouge abondance, il sentait lui monter aux lèvres la plainte furieuse du moribond qui voudrait retenir la vie. Sur la table paradait une grande carafe d’eau, d’une limpidité révoltante.
Le plafond du premier grinça soudain sous un pas pesant et un petit air d’accordéon dévala l’escalier du vestibule : « Allez, viens boire un p’tit coup à la maison, y’a du blanc, y’a du rouge, du saucisson et Gillou avec son p’tit accordéon ». C’était fort opportunément le neuvième convive qui se rappelait au bon souvenir des huit infortunés : Eh oui ! Jean-Sébastien Bach qui, là-haut, s’encanaillait à l’aide d’un piano à bretelles !

Comme tout honnête homme soucieux de culture musicale, et même de culture tout court, vous n’êtes pas sans savoir que Jean-Sébastien Bach avait, lors de sa maturité, définitivement quitté la lande de Lünebourg, Leipzig, Weimar et le Venusberg pour s’installer, au soir de sa vie, à Montmartre, dans un vague bastringue situé à l’angle de la rue Saint-Vincent et de la rue des Saules.
Il y travaillait avec amour, acharnement et probité. Il avait même, au débotté, proclamé son amour pour la France et tenu des propos surprenants et saugrenus, devant ses voisins quelque peu éberlués qui ne l’avaient pas très bien compris : « Pourquoi voulez-vous que nous dissimulions plus avant l’émotion profonde et sincère qui nous étreint tous, hommes et femmes, qui sommes ici chez nous, dans Paris debout pour se libérer, et qui a su le faire de ses mains. Il y a des minutes qui dépassent chacune de nos pauvres vies. Paris ! Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé ! Mais Paris libéré ! »
Toujours les fameuses prémonitions d’artistes !

Fort tard dans la nuit, en chemise à carreaux, bretelles, vaste moustache, chique calée dans la gencive droite et béret basque de travers sur l’occiput, sa silhouette massive, penchée sur ses partitions, était devenue familière aux noctambules et aux amoureux qui remontaient de la place du Tertre vers le café de la Mère Catherine.
Quelques années plus tard, Jean-Sébastien Bach, après avoir une fois de plus donné la mesure de la diversité de son génie en composant sa sonate opus 36 pour accordéon seul, inspiré du si fameux air populaire « monte là d’ssus, mont’làd’ssus ! et tu verras », quittait la butte Montmartre, s’embarquait pour les Amériques et débarquait, sa valise en carton à la main, aux pieds de la statue de la Liberté.

Il habita longtemps Manhattan et le Bronx, à l’ombre du pont de Brooklyn. Times Square s’honorait chaque soir de sa silhouette cahotante et gothique dérivant sournoisement, toute honte bue, vers le Sofitel voisin.
Conscient de l’énorme apport que la musique lui devait, il changea résolument de registre. Associé à Truman Capote, il consacra les dernières années de sa vie à rédiger des romans policiers et des œuvres d’anticipation. Là comme ailleurs, il ne tarda point à exceller et devint célèbre, bien des années plus tard, sous le pseudonyme de Ray Bradbury.
Pendant ce temps-là, à Paris, sur la butte Montmartre, des hauteurs de Belleville aux jardins du Luxembourg et à l’île Saint-Louis, lorsqu’au printemps les lilas fleurissaient le bois de Meudon, les chanteurs de rues ensemençaient les emblavures de ses rythmes divins.
Mais ne voilà-t-il pas qu’un jour, au bout de quelques années de labeur acharné, sa musique, à force d’énergie déployée, était devenue si riche, si sensible, si fraîche, si solide, qu’elle constituait une véritable boisson, non pas seulement pour l’esprit mais bien aussi pour le corps. Il suffisait d’écouter pendant quelques minutes son Art de la Fugue ou son Agneau mystique pour se sentir merveilleusement désaltéré.
Aussi absurde que cela aurait pu paraître, la musique de Jean-Sébastien Bach possédait mystérieusement le pouvoir d’abreuver les gosiers altérés. Même les Bretons n’y résistaient pas ! Par sa vigueur, son intensité, sa majesté sonore, sa qualité de pâte, sa puissance de synthèse, cette musique était devenue un condensé des mystères essentiels de la création.
Certains affirment même que l’artiste, ému de pitié devant le capitaine Haddock perdu dans le massif du Tibesti et hurlant de désespoir « le pays de la soif », avait poussé son génie, qui était parvenu à faire d’elle le véritable trait d’union entre la matière inerte et la vie. Yes, ladies and gentlemen, sa musique était beauté, elle était force sauvage, elle était tout simplement ambroisie et divin breuvage.
En bas, autour de la grande table, les convives se levaient un à un et, comme les somnambules de la « Nuit des Morts vivants », s’avançaient en groupe compact vers les escaliers.

Le pied droit sur la première marche, ayant troqué son habituel feutre Bross et Clackwell au profit d’un casque colonial raflé sur le guéridon du vestibule, Jacques, désireux d’incarner le général Goethals à l’assaut de la colline San Juan, dégaina un sabre imaginaire (prière de se rapporter à Arsenic et vieilles dentelles), hurla à pleine voix « Châââârge ! » et se rua dans les escaliers, suivi d’une cavalcade assoiffée de sept mousquetaires pleins de fièvre.
Hélas ! Au premier étage, le salon de musique s’ouvrit devant un Jean-Sébastien Bach, chemise ouverte sur un ventre poilu, plongé dans une torpeur lourde et suspecte. Yves le fit aussitôt souffler dans un éthylotest. « Whouahouh ! » s’exclama t’il en consultant l’échelle : 3,85 grammes d’alcool par litre de sang, dont 70% de Château Pichon-Longueville, comtesse de Lalande. Il avait manifestement abusé de la première bourrée en ut majeur et du stabat mater. Que faire ? On l’abandonna dans les bras de Morphée.

Derrière lui, une fort étrange machine déployait ses enceintes massives Halcro DM 68 monoblock, ses dômes argentés, ses volumes impressionnants : Klipshorn Elipson Synergy, pourvus de cônes en kevlar de 350 watts, précédant deux amplis Aventage RX-A3020, calibrage YPAO héritage amélioré. Mais laissons la parole à ma belle-sœur Marie-Françoise, miraculée lors d’un voyage à Lourdes. Emergeant, les cheveux trempés, de la piscine miraculeuse en compagnie d’une cohorte de tétraplégiques, elle s’était rendu compte qu’elle ne pouvait plus s’exprimer qu’en anglais : « Beneath the elegant shell of a HALCRO-DM68 amplifier, lies a combination of revolutionary circuitry, meticulous attention to plain common sense. The power supply and audio compartments are physically separated and heavily shielded to retain purity of the signal.”
Cet instrument monumental et bizarre évoquait, de par sa forme générale, les tours Pétronas de Kuala Lumpur ou la Machine à voyager dans le temps de Herbert Georges Wells. Mais laissons encore la parole à ma belle-sœur, Marie Françoise : « Of course ! indeed ! It’s a long way to Tipperary ! “
Vielen Dank und gute Nacht, Marie-Françoise !
Les deux grandioses enceintes dégageaient six haut-parleurs en kevlar mais les faces latérales apparaissaient bizarrement pourvues d’une série de petits robinets nickelés de marque Jacob Delafon – Ayon crossfire.

Merveille de la technique moderne, il vous suffisait de choisir votre thème sonore et de venir directement vous abreuver au robinet correspondant. Jacques et Marie-Hélène choisirent le 7ème robinet, une gigue ; Philippe le 10ème, une fughetta ; Nicole le 16ème, une ouverture complète ; Pascale le 25ème, un adagio aux fioritures abondantes (adagio ma non troppo con molto pizzicati, parmesan, mozarella, osso bucco y lasagnes).
Yves, lui, jeta son dévolu sur le 26ème, une sarabande fort ornementée, alternativement pour la main gauche et la main droite (allegretto molto vivace, pero e pericoloso sporghersi, con molto chianti, saltimbocca di maiale al pesto genovese).
Raoul et Martine optèrent, après réflexion prolongée, pour un quod-libet dans lequel Bach avait adapté, par-dessus les basses, deux chansons populaires : “ Ich bin so lang nicht bei dir gewesen” (Il y a si longtemps que je n’ai plus été près de toi), une allusion manifeste au thème que la longue série des variations ne permettait plus de retrouver, et « Kraut und Rüben haben mich vertrieben »
(Choux et betteraves m’ont chassé), qu’on peut traduire ainsi :« Tout ce fatras me fatigue ! »
Yves, agnostique convaincu et candide, demeurait persuadé que c’étaient bien Charlton Helston et Yul Brynner qui avaient inspiré l’Ancien Testament. Il demanda néanmoins le silence et, de sa baguette d’ivoire et d’ébène, frappa la partition disposée sur son pupitre du geste qu’eut jadis le divin Moïse au rocher d’Horeb …
Alors, la Terre s’ébranla et chancela,
Et les assises des cieux frémirent.
Un immense éclair déchira les Nuées.
Yahvé tonna du haut des Cieux.

Ce ne fut plus Lézarouan mais Canaan et, de tous les robinets, le vin rouge se mit à couler !
Le praticien thaumaturge se tourna vers l’assistance et, la main droite posée sur le cœur à la Ben Ali, laissa tomber, énigmatique : « Prenez et buvez. Ceci est mon Saforelle ! » ! Personne ne le comprit mais tout le monde obéit !
Après un temps de silence interminable, de véhéments borborygmes, d’étranges sons évoquant des régurgitations d’évier, de vigoureux et enthousiastes « Yééééèaèaèahh » poussés par Jacques, troublèrent la solennité de la salle de musique. Lapant avec véhémence le vin qui ruisselait à flots des enceintes, comme l’eau bénite doit suinter de la grotte de Lourdes les nuits de pleine lune, huit gosiers, qui pensaient s’être perdus dans l’immensité des lacs de sel et des mirages, éclusaient le vin rouge avec une énergie digne d’une meilleure cause.

Ils se retrouvèrent autour d’un gigot de mouton pompé et alors, les exclamations d’allégresse fusèrent autour de la table, redevenue joyeuse, en littéral feu d’artifice : « J’avais soif ! » / « Tu la crevais ! » / « Il claquait du bec » / « Nous l’avions sèche » / « Vous ne pouviez même plus baver ! » / « Ils étaient bien petits ! » / « Que le Diable me patafiole si je n’ai pas encore plus soif qu’avant que j’aie bu ! » / « Que tu te réjouisses de pomper un autre glass, je n’en ai jamais douté ! » / « N’eut-il pas fallu que vous vous résolussiez à boire tout seul, si vous n’eussiez pas eu l’avantage de nous rencontrer ? » / « S’il arrivait ou se produisait que ces deux pilons se refusassent à payer chacun sa tournée, il faudrait que je me contraignisse, dussé-je courir le risque qu’ils ne m’invectivassent, à affirmer que ce sont deux rudes salauds ! ».
Les viandes prestement expédiées dans la cale cinq, une nouvelle cavalcade ébranla les escaliers de la Butte, de plus en plus durs aux amoureux ! Au prix de quelques glissades et autant de culbutes, la joyeuse équipe recommença à téter les robinets à un train d’enfer, avec un enthousiasme de grands repentis de la Croix d’Or.
La nuit s’abandonnait doucement, paupières baissées et sur l’océan pointait l’aurore aux doigts de rose, une langueur feutrée se répandait des soupiraux et remplaçait l’excitation fébrile de la veille, par une lassitude, une nonchalance, caractéristiques de la levée prochaine des enchantements. Et la soif, toujours présente, une fois de plus rongeait le gosier de nos joyeux drilles.
Ils se levèrent donc tous et cahotèrent fort héroïquement vers l’escalier mais, malgré les exhortations pâteuses et molles de Jacques qui continuait à dégainer son sabre imaginaire en poussant de rauques : « Chaaarrggeeeuh-heuh-heuh! », la progression se révélait impossible sans l’intervention d’improbables sherpas d’accompagnement, importés d’urgence de Namche-Bazaar.
Alors, résignés, ils s’inclinèrent devant un sort contraire et s’entassèrent dans l’ascenseur que le bon docteur s’était aménagé pour gagner plus commodément sa salle de musique, en prévision du jour où, devenu vieux, l’âge impitoyable lui aurait fermé l’accès aux étages.
Ils n’étaient pas « quinze matelots sur le coffre du mort » mais huit fêtards en goguette, comprimés en sardines qui, comme elles, avaient perdu la tête dans l’étroit habitacle, sans huile ni aromates. « Sans voix, sans mains et sans genoux, sardines, priez pour nous ! »
Huit joyeux drilles, qui comme cinquante millions de personnes dans le monde, faisaient confiance à Stannah, le leader mondial des monte-escaliers. L’ascenseur s’ébranla pesamment et gagna le premier étage, puis le second, le troisième… Y avait-il un troisième ? Mais déjà « Stannah », leur module lunaire, escaladait le cinquième et ultime étage, cela ne pouvait-être qu’un grenier ou un vague galetas.

C’est toujours mon angoisse, quand je vois mon ami Xavier enfourcher cet appareil, caparaçonné comme un astronaute, que la machine s’emballe soudain et que, propulsé en orbite, il se perde à jamais, étoile filante, dans l’immensité du cosmos.
Et c’était précisément ce qui venait de se produire. Avec Stannah, vivez dangereusement », disait bien la notice. Au dernier étage, l’ascenseur ne s’arrêta pas !
Bonnes gens qui, par les crépuscules d’été, rêvez aux étoiles, s’il vous arrive un jour de suivre le grand jalon du ciel boréal, fixez d’abord votre attention sur Sirius, la plus brillante de la voûte étoilée, regardez-la bien. En 3400 avant Jésus-Christ, le 17 juin fut une date importante car c’est en ce jour que, pour la première fois après sa disparition annuelle, on observa, avant l’aube, Sirius, l’étoile-chien, au-dessus de l’horizon oriental. Cette date correspondait à la première crue du Nil.
Suivez toujours le grand jalon. Gagnez maintenant les trois Mages du baudrier d’Orion, the Hunter, puis, dans l’amas des Hyades, la géante rouge, élément majeur du premier astérisme boréal, l’étoile royale des Perses, Aldebaran.

Enfin vous parviendrez à un amas scintillant de petits points lumineux qui paraissent danser. Je vous en prie, regardez-les bien pour un ultime adieu car, pris dans la fuite éperdue de l’infini des mondes, ils ne tarderont pas à s’évanouir dans l’éternité des possibles. Regardez-les une dernière fois car ce sont nos amis propulsés par l’aéronef « Nostromo », non, pardon, « Stannah », qui depuis des millénaires, s’obstinent là-haut à s’abreuver des Variations Goldberg interprétées par Glen Gould, et qui persistent à s’en gargariser jusqu’à s’en rincer les dents de sagesse.
Si le comte de Gobineau était encore parmi nous et pouvait les admirer, il les appellerait tout simplement « Les Pléiades ».
En guise de postface, il est de mon honneur de préciser, malgré mes propos sans doute irrévérencieux sinon iconoclastes, que mon intention n’était certes pas de mésestimer ou de chercher à dévaloriser ce musicien considérable qu’est Jean- Sébastien Bach. Je n’en ai ni le désir ni, bien évidemment, la compétence.
Et surtout, surtout, comment pourrais-je brocarder une telle musique, si merveilleuse d’intelligence, à une époque maudite, dramatique où la jeunesse se vautre, décérébrée, lobotomisée, suicidaire, secouée de convulsions épileptiques, droguée jusqu’ à l’os, abrutie de ces rythmes nègres répercutés en appels de singes hurleurs sous les vastes frondaisons de la forêt primaire, à une époque où, consternés, nous assistons impuissants à cette agitation d’aliénés, clonique, discordante et sauvage, qui vous ramène à des époques préhistoriques, à des sensations et des frémissements d’âge de pierre, aux insondables effrois des temps primitifs, lorsqu’au milieu des solitudes du vieux monde hurlaient des hommes au gosier de singe.
Mais alors, où ai-je voulu en venir ? Une dernière anecdote et je vais vous le dire. Ollivier de la Perrière est ce qu’on pourrait appeler un romantique. Un soir, à la Scala de Milan où une charmante petite parisienne l’avait accompagné, il me rendit compte de l’incident qui va suivre. On donnait ce soir-là, Lucia di Lammermoor, de Gaetano Donnizetti, et la divine soprano Katia Ricciarelli, expirant ensanglantée sur un dernier octave, venait de se jeter dans un puits après avoir, abandonnée et trahie, renoncé au monde des vivants.

Olivier, la tête en feu, la gorge serrée, le cœur broyé par l’émotion, le plastron inondé de larmes, s’était désespérément retenu dans son enthousiasme de ne pas déchiqueter le tapis à coups de dents. Il se retourna vers sa compagne, dont le visage étonnement lisse dénotait l’absence totale de la plus élémentaire émotion. « Comment avez-vous trouvé ça, réussit-il à, articuler d’une voix rauque ? » Lui adressant son sourire le plus désarmant, la jouvencelle lui répondit avec simplicité : « ça ne me gêne pas!» Le malheureux en eut le souffle coupé !
Je ne sais plus quelles questions perverses et sournoises j’avais adressées à cette visiteuse médicale qui achevait son exposé sur les avantages comparés des récepteurs de l’angiotensine II et des inhibiteurs de l’enzyme de conversion. Sans doute avais-je cru y déceler l’indice d’une relative inculture sous-jacente. Elle me répondit simplement : « Mais monsieur, il ne faut pas me soumettre à un tel interrogatoire. Vous savez, je n’y connais rien et, de plus, je crois que je suis complètement idiote. Ce poste de visiteuse, je l’ai obtenu par brigue et j’ai simplement appris mon texte par cœur ».
Très ému de cette réaction, je me rappelle m’être levé avant de l’embrasser. Quelques années auparavant, découvrant soudain sa franchise et sa force aristocratique, je lui aurai fait la révérence. Elle ne cherchait pas à donner le change, à duper. Elle ne se donnait pas la peine de mentir et se jugeait, croyait-elle, à sa juste valeur alors qu’elle se dressait soudain au-dessus de la multitude, à l’instar des Grecs de Périclès et de Thémistocle. « Nous autres Véridiques », tel était le nom que se donnaient les nobles dans la Grèce antique. Les forts ne mentent pas, ils ne se donnent pas cette peine, ils sont francs, voire cyniques, par dédain.
« Nous autres Véridiques »… Toutes les races, serviles par nature ou asservies par les circonstances, mentent. Comment expliquer autrement que par le sentiment d’une insuffisance de la personnalité ce besoin de se rendre intéressant, d’affecter des états d’âme d’emprunt ?

Faut-il aussi y voir l’influence sans cesse grandissante de la femme dans nos sociétés occidentales ? A Sainte-Hélène, Napoléon en faisait à l’amère constatation : « Nous autres, peuples de l’Occident, nous avons tout gâté en traitant les femmes comme nos égales. Nous les avons portées, à grand tort, presque à l’égal de nous. Les peuples d’Orient ont plus d’esprit et de justesse. Ils les ont déclarées la véritable propriété de l’homme et, en effet, la nature les a faites nos esclaves. Ce n’est que par nos travers d’esprit qu’elles ont prétendu être nos souveraines ».
Je vais vous le confier en conclusion, j’écoute sans déplaisir et même avec un réel intérêt les Variations Goldberg interprétées par Glen Gould. Non, vraiment, « ça ne me gêne pas » mais comment vous expliquer… voilà… je ne suis pas enthousiasmé, je ne brûle pas, je ne verse pas de larmes, je n’ai pas envie de me précipiter dans le cratère du Niragongo en entonnant un péan guerrier ! Peut-être même que ça m’emmerdre un peu parfois !
Et pourtant ! Qu’est- ce que j’ai pu brûler dans ma vie. A en demeurer incandescent, des années plus tard, après les fabuleux embrasements de mon éternelle jeunesse, dont le ronflement sauvage de l’incendie me trouble encore !
Je crois en effet qu’une éducation musicale approfondie, quasiment professionnelle, est nécessaire pour apprécier pleinement ce numéro de virtuosité

Maintenant, si l’on accorde quelque crédit à l’adage « Frappe toi le cœur, c’est là qu’est le génie ! », peut-être que Bach rate ici sa cible mais c’est aussi la raison pour laquelle je n’ai ni la capacité, ni la compétence nécessaires pour apprécier les Variations Goldberg, pas plus d’ailleurs que je ne suis apte à comprendre la théorie de la Relativité restreinte découverte par Henri Poincaré. Ou la constante de Max Planck !
C’est ainsi, il faut s’y résoudre, il y a bien d’autres domaines, sur cette planète, qui peuvent nous transporter à l’acmé de l’exaltation esthétique sans pour cela couper les cheveux en quatre et se livrer à d’inconfortables contorsions psychologiques, à d’acrobatiques grimaces et simagrées.
Mes chers amis, trouvons donc, je vous en prie, la simplicité de l’avouer en nous dégageant des convenances et des modes et surtout, à l’instar des compagnons d’Alcibiade et de Thémistocle, en restant nous-mêmes. En nous admettant tels que nous sommes, Véridiques, tels que Dieu nous a créés !
Evitons de nous associer, par simple panurgisme ou aussi et surtout par cet insupportable snobisme si français, à ces cohortes de bobos qui, trop souvent, portent aux nues, l’espace d’une saison, un livre (signé Amélie Nothomb, ah ! j’irai cracher sur Nothomb), un sculpteur, Botero par exemple, ou le compresseur de voitures dont j’ai oublié le nom, ou un peintre, n’importe lequel. Nous avons ici, hélas l’embarras du choix !
Combien de fieffées andouilles ont contracté, ces dernières semaines, une fluxion de poitrine en faisant des heures de queue, sous la pluie, au Grand Palais, pour ouvrir une grande bouche ahurie devant les sottises laborieusement torchées par Edward Hopper, un obscur peinturlureur américain ?
Morbleu ! C’est une chose indigne, lâche, et infâme,
De s’abaisser ainsi jusqu’à trahir son âme.
Je veux que l’on soit Homme et qu’en toute rencontre,
Le fond de notre cœur dans nos discours se montre,
Que ce soit Lui qui parle et que nos sentiments
Ne se masquent jamais sous de vains compliments.
(Molière / Le Misanthrope)
Voici maintenant venu le moment de dire adieu à Jean-Sébastien Bach, notre héros. Remettons-nous en mémoire cette si fameuse oraison funèbre prononcée lors de ses obsèques solennelles, dans la crypte du cimetière d’Arlington, par le président Abraham Lincoln, lui-même : « Entre ici, Jean-Sébastien, avec ton terrible cortège ! Entre dans ce noble Moulin avec nos frères de l’Ordre de la Nuit. Comme Leclercq entra aux Invalides avec son cortège d’exaltation dans le soleil d’Afrique, toi, Jean-Sébastien, tu erres dans cette nuit d’horreur, constellée de tortures, avec ce long cortège d’ombres défigurées sur le champ de bataille de Gettysburg ».

Entends maintenant résonner, Jean-Sébastien, tes Variations Goldberg que Glen Gould va jouer pour nous, dignement accompagné par la fanfare des parachutistes de l’école militaire de West-Point.
Oui ! Ces Variations entraînent la résurrection de toutes les tristes victimes de cette guerre fratricide, la résurrection des valeureux Confédérés de la guerre de Sécession car, à la fin, les valeurs nobles sont toujours vaincues. L’Histoire est le récit de leurs défaites renouvelées !
Raoul Lélias, 2012

